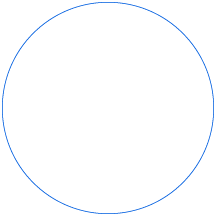FAQ
Archives
Qu'est-ce que la norme ISAD(G) ?
ISAD(G) est l’acronyme de « Norme générale et internationale de description archivistique », adoptée par le Comité sur les normes de description du Conseil international des archives (ICA). Ce document fournit des règles générales pour la description de documents d’archives, quelle que soit leur forme ou leur support matériel. L’objectif principal est de créer des représentations précises et pertinentes des documents afin de faciliter leur accès et leur compréhension. La norme définit 26 éléments de description, organisés en sept zones d’information, qui peuvent être combinés pour constituer la description d’une entité archivistique.
Qu'est-ce que la norme ISAAR (CPF) ?
ISAAR (CPF), qui signifie « Norme Internationale sur les notices d’autorité utilisées pour les Archives relatives aux collectivités, aux personnes ou aux familles », établit des lignes directrices pour la création de notices d’autorité. Ces notices décrivent les entités (organisations, personnes physiques ou familles) qui ont produit ou géré les archives. L’objectif est de fournir un accès normalisé aux documents en contrôlant la création et l’utilisation des points d’accès. ISAAR (CPF) va au-delà des notices bibliographiques en incluant des informations plus détaillées sur le contexte de production des documents, ce qui est crucial pour leur interprétation.
Comment ISAD(G) et ISAAR (CPF) sont-elles liées ?
Les normes ISAD(G) et ISAAR (CPF) sont complémentaires et conçues pour être utilisées ensemble dans un système de description archivistique. Tandis que ISAD(G) se concentre sur la description des documents d’archives eux-mêmes, ISAAR (CPF) fournit le cadre pour décrire les producteurs de ces documents, c’est-à-dire les entités qui les ont créés ou reçus. Les liens entre les notices d’autorité des producteurs ISAAR (CPF) et les descriptions d’archives ISAD(G) permettent d’enrichir le contexte des documents et d’améliorer la recherche.
Qu'est-ce que la description à plusieurs niveaux en archivistique ?
La description à plusieurs niveaux est une approche fondamentale en archivistique, explicitée dans ISAD(G). Elle consiste à décrire un ensemble d’archives en commençant par le niveau le plus général (le fonds d’archives), puis en descendant progressivement vers des niveaux plus spécifiques comme le sous-fonds, la série organique, le dossier ou la pièce. Ce principe, qui découle du respect des fonds, permet de situer chaque unité de description dans son contexte hiérarchique, d’adapter le niveau de détail des informations et d’éviter les répétitions inutiles.
Quels sont les principaux types d'informations inclus dans une description archivistique ISAD(G) ?
Selon ISAD(G), une description archivistique est structurée en sept zones d’information pour organiser les données :
- Identification : informations essentielles pour reconnaître l’unité (par exemple, la référence, l’intitulé, les dates et le producteur).
- Contexte : détails sur l’origine et l’histoire des documents.
- Contenu et structure : informations sur le sujet des documents, leur évaluation et leur classement.
- Conditions d’accès et d’utilisation : restrictions d’accès, conditions de reproduction et langues des documents.
- Sources complémentaires : liens vers des originaux, copies ou documents connexes.
- Notes : informations qui ne peuvent être placées dans d’autres zones.
- Contrôle de la description : détails sur la création et la mise à jour de la description.
Qu'est-ce que le principe du respect des fonds ?
Le principe du respect des fonds est une pierre angulaire du domaine archivistique. Il stipule que les archives d’un producteur donné (une personne, une famille, une organisation) doivent être conservées ensemble, sans être mélangées avec celles d’autres producteurs, afin de préserver leur provenance et leur contexte d’origine. Ce principe garantit l’authenticité et l’intégrité des documents. La description à plusieurs niveaux de ISAD(G) est une application pratique de ce principe, car elle permet de décrire les fonds dans leur ensemble avant de détailler leurs subdivisions, reflétant ainsi l’organisation naturelle des documents issue de leur activité.
Qu'est-ce qu'un tableau de tri et à quoi sert-il ?
Un tableau de tri est un outil essentiel pour la gestion des archives, qu’elles soient physiques ou numériques. Il liste systématiquement tous les documents produits et reçus par une institution, en indiquant pour chaque type de document son délai de conservation minimal (lié à son utilité administrative ou juridique) et sa destination définitive (conservation permanente ou élimination). L’utilisation d’un tableau de tri permet de réduire le volume des archives conservées, d’optimiser les coûts et l’espace de stockage, et d’améliorer l’efficacité de la recherche d’informations. Il assure également la conformité avec les obligations légales de conservation.
Qu’est-ce qu’un SAE (Système d’archivage électronique) et à quoi cela sert-il ?
Le SAE permet la mise en place d’une solution d’hébergement des documents numériques. Cela permet de retrouver et d’indexer les différents flux documentaires dans un outil informatique centralisé. L’implémentation d’un SAE facilite, entre autres, le classement, réduit le temps de recherche et élimine les coûts inhérents au stockage physique des archives papiers.
Comment garantir la conservation à long terme des documents électroniques ?
La conservation à long terme des documents électroniques est une tâche complexe qui nécessite une stratégie proactive. Les éléments clés incluent le choix de formats de fichiers pérennes (ouverts et largement diffusés comme le PDF/A) pour assurer leur lisibilité future. Il est également crucial de préserver les métadonnées qui décrivent le document (auteur, date, contexte) et de les associer de manière unique à l’archive. Enfin, le support de conservation (disque dur, CD) doit être choisi en fonction de sa stabilité et de sa disponibilité technologique, avec des migrations régulières prévues pour s’adapter à l’évolution des technologies.
Quel est le rôle des métadonnées dans l'archivage numérique ?
Les métadonnées sont des données qui décrivent d’autres données. Dans l’archivage numérique, elles sont cruciales pour garantir l’accessibilité et la compréhension des documents à long terme. Elles fournissent des informations sur le contexte de création, le contenu, la structure et la gestion des archives. Un bon ensemble de métadonnées permet de retrouver les documents par des requêtes spécifiques et de comprendre leur signification sans avoir à accéder au contenu complet. L’association des métadonnées avec les documents par un identifiant unique est essentielle, même si elles sont stockées séparément.
Qu’est ce que l’OAIS ?
L’OAIS (Open Archival Information System) ou l’ISO 14721 est la norme fondamentale et le modèle de référence conceptuel pour l’archivage numérique à long terme. Elle décrit les fonctions et les responsabilités d’un système d’archivage numérique, indépendamment de sa technologie ou de son implémentation. C’est un cadre théorique mais essentiel pour la conception de tout système d’archivage électronique (SAE).
Qu’est ce que eIDAS ?
Le règlement européen sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques (eIDAS) établit un cadre juridique pour les signatures électroniques, les cachets électroniques, et les services d’archivage électronique qualifiés. eIDAS V2 intègre spécifiquement un service de confiance pour l’archivage qualifié, conférant une présomption d’intégrité et d’origine aux documents conservés.
Qu’est ce que le format PDF/A ?
PDF/A tel que spécifié dans l’ISO 19005 est le format de document portable pour l’archivage. Il s’agit d’un sous-ensemble du format PDF, conçu spécifiquement pour l’archivage à long terme des documents électroniques. Il garantit que les documents s’afficheront exactement de la même manière dans le futur, en intégrant toutes les informations nécessaires (polices, images, métadonnées) et en interdisant les fonctionnalités qui pourraient nuire à la pérennité (ex: scripts, liens externes).