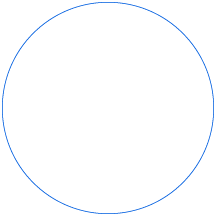FAQ
Pensée systémique
Que sont les systèmes et comment les identifier ?
Un système est un ensemble de parties interconnectées qui, ensemble, produisent un effet différent de la somme des effets de chaque partie prise isolément. Les systèmes se trouvent partout, des organismes biologiques comme les animaux et les arbres aux constructions humaines comme les écoles, les villes, les usines et les économies. Ils se caractérisent par des parties identifiables qui s’influencent mutuellement et produisent collectivement un résultat unique. Contrairement à une simple collection d’éléments sans connexions ou fonctions particulières (comme du sable sur une route), modifier les parties d’un système peut fondamentalement changer, voire détruire le système lui-même. Des éléments intangibles comme la fierté d’appartenir à une organisation ou l’excellence académique peuvent aussi être des composantes importantes d’un système. Les systèmes peuvent également être imbriqués dans des systèmes plus grands, formant ainsi des hiérarchies.
Qu’est-ce que le mode de pensée systémique ?
Le mode de pensée systémique (ou « systems thinking ») est un cadre de compréhension du monde qui reconnaît l’interconnexion de ses différentes parties et la manière dont elles s’influencent mutuellement au fil du temps. L’objectif de cette approche est de promouvoir cette vision holistique et d’encourager un dialogue constructif sur les systèmes sociaux complexes, en fournissant les outils et le langage nécessaires à cet effet. Le mode de pensée systémique incite à poser des questions approfondies, à affirmer avec audace et à réviser librement, valorisant les apprenants et les penseurs par rapport aux experts et aux suiveurs.
Pourquoi les systèmes nous surprennent-ils souvent ?
Les systèmes nous surprennent pour plusieurs raisons liées à leur complexité inhérente et à nos perspectives limitées. L’une des raisons est que nous traçons souvent des frontières inadéquates autour des systèmes que nous étudions, ignorant des stocks et des flux importants qui sont externes à notre frontière définie mais qui influencent néanmoins le comportement du système. Un autre facteur est la présence de délais au sein des systèmes (délais de perception, délais de réponse, délais de livraison), qui peuvent provoquer des oscillations inattendues ou des réponses lentes aux interventions. Les relations non linéaires, où la cause et l’effet ne sont pas proportionnels, contribuent également à un comportement surprenant ; de petits changements peuvent parfois avoir des effets disproportionnellement importants, et vice versa. De plus, nous avons tendance à nous concentrer sur les événements individuels plutôt que sur les modèles de comportement sous-jacents générés par les structures du système. Enfin, la rationalité limitée signifie que les acteurs individuels au sein d’un système prennent des décisions basées sur des informations limitées et des intérêts locaux, ce qui peut ne pas correspondre au bien-être du système dans son ensemble, entraînant des conséquences imprévues.
Qu'est-ce que la rationalité limitée et comment affecte-t-elle le comportement du système ?
La rationalité limitée décrit la logique qui pousse les individus ou les entités au sein d’un système à prendre des décisions ou des actions qui semblent rationnelles et bénéfiques de leur perspective limitée, mais qui peuvent ne pas être raisonnables ou optimales pour le système dans son ensemble. Les acteurs d’un système ne sont pas omniscients ; ils opèrent avec des informations incomplètes, se concentrent sur des préoccupations immédiates et ne prévoient souvent pas pleinement les impacts plus larges de leurs actions sur l’ensemble du système. Cela signifie que les décisions individuelles, même si rationnelles du point de vue de l’acteur, peuvent collectivement conduire à un comportement sous-optimal, voire dommageable, pour le système. Par exemple, un pêcheur essayant de maximiser sa prise pour subvenir aux besoins de sa famille pourrait pratiquer la surpêche en raison de connaissances limitées sur l’état de la population de poissons et des incitations auxquelles il est confronté, contribuant à l’effondrement de la pêcherie. La rationalité limitée peut créer des pièges systémiques, où des actions individuelles bien intentionnées mènent à des résultats systémiques indésirables.
Que sont les pièges systémiques et pourquoi sont-ils si difficiles à éviter ?
Les pièges systémiques sont des schémas de comportement récurrents dans les systèmes qui mènent à des résultats indésirables ou sous-optimaux. Parmi les exemples courants, on trouve la tragédie des communs (où l’intérêt individuel mène à l’épuisement d’une ressource partagée), la résistance aux politiques (où les interventions visant à résoudre un problème sont contrecarrées par les boucles de rétroaction du système), la dérive vers la faible performance (où les standards de performance sont progressivement abaissés), et l’escalade (où les acteurs en compétition augmentent continuellement leurs actions en réponse à celles de l’autre).
Ces pièges sont difficiles à éviter car ils sont souvent alimentés par la structure sous-jacente du système et la rationalité limitée des acteurs impliqués. Pour y remédier, il est essentiel de comprendre les boucles de rétroaction et les incitations qui perpétuent le comportement problématique, et cela nécessite souvent une refonte du système.
Que sont les points de levier dans un système, et quels sont des exemples d'endroits plus ou moins efficaces pour intervenir ?
Les points de levier sont des endroits au sein d’un système où un petit changement peut entraîner des modifications significatives de son comportement. Cependant, tous les points de levier ne sont pas également efficaces, et les plus impactants sont souvent les moins évidents et les plus combattus.
Les points de levier faibles incluent les paramètres (comme les subventions ou les taxes) et les tampons (la taille des stocks stabilisateurs). Les points de levier intermédiaires impliquent les structures de stocks et de flux, les délais et les boucles de rétroaction équilibrantes.
Les points de levier élevés sont liés aux boucles de rétroaction de renforcement, aux flux d’information, aux règles du système (incitations et sanctions), au pouvoir d’auto-organisation, et finalement, aux objectifs du système et aux paradigmes ou mentalités sous-jacents qui le façonnent. Changer les paradigmes est considéré comme le point de levier le plus élevé, car cela peut modifier fondamentalement les objectifs, les règles et les flux d’information du système.
Quelle est l'importance des paradigmes dans les systèmes et comment leur modification peut-elle entraîner des changements significatifs ?
Les paradigmes, ou mentalités, sont les points de levier les plus profonds d’un système. Ce sont les accords sociaux partagés sur la nature de la réalité d’où découle tout le reste d’un système – ses objectifs, ses flux d’informations, ses boucles de rétroaction, ses stocks et ses flux. Les paradigmes sont les sources des systèmes. Lorsque les croyances et les hypothèses sous-jacentes (le paradigme) qui façonnent un système changent, cela peut entraîner des transformations radicales et fondamentales dans la façon dont le système fonctionne. Par exemple, passer d’un paradigme de croissance sans fin à un paradigme de durabilité peut modifier considérablement les systèmes économiques et environnementaux. Bien que les paradigmes soient souvent profondément enracinés et très résistants au changement, envisager l’idée que les visions du monde actuelles ne sont pas des vérités absolues peut être incroyablement stimulant. Remettre en question et changer le paradigme dominant peut ouvrir la voie à de nouvelles possibilités, à des structures de système différentes et à des résultats auparavant impensables. C’est là que des changements profonds et durables peuvent se produire.
Comment la compréhension des stocks et des flux peut-elle nous aider à comprendre le comportement des systèmes ?
Les stocks et les flux sont des composants fondamentaux des systèmes qui nous aident à comprendre leur comportement au fil du temps. Un stock est une accumulation de matière ou d’information à un moment donné, similaire à une réserve ou une quantité. Des exemples incluent l’eau dans une baignoire, une population ou de l’argent dans une banque. Les stocks changent au fil du temps sous l’action des flux, qui sont les taux de changement entrant ou sortant du stock (par exemple, le remplissage et la vidange, les naissances et les décès, les dépôts et les retraits). Comprendre la dynamique de la façon dont les stocks changent en réponse aux flux est crucial pour saisir le comportement des systèmes complexes. Les stocks changent généralement lentement, même lorsque les flux changent soudainement, agissant comme des délais, des retards, des tampons ou des sources d’élan au sein d’un système. Cette capacité de tampon permet aux entrées et aux sorties d’être temporairement indépendantes, permettant aux systèmes d’absorber les chocs et de maintenir un certain degré de stabilité.
Que sont les boucles de rétroaction et quels sont les deux types principaux ?
Les boucles de rétroaction sont les mécanismes de contrôle au sein d’un système qui permettent à un changement dans un stock d’affecter les flux entrants ou sortants de ce même stock, créant une chaîne fermée de connexions causales. Elles sont la clé pour comprendre pourquoi les systèmes présentent des modèles de comportement cohérents au fil du temps. Il existe deux types principaux :
- Boucles de rétroaction équilibrantes (ou régulatrices) : Ces boucles visent un objectif ou la stabilité. Elles œuvrent à maintenir un stock à une valeur donnée ou dans une fourchette souhaitée. Si un stock est poussé trop haut, une boucle équilibrante agira pour le faire baisser, et s’il est poussé trop bas, elle essaiera de le faire remonter. Elles s’opposent à la direction du changement imposée au système. Un exemple courant est un thermostat régulant la température d’une pièce, où l’objectif est la température désirée et où la boucle de rétroaction active le chauffage ou la climatisation pour réduire l’écart.
- Boucles de rétroaction de renforcement (ou amplificatrices) : Ces boucles amplifient le changement. Elles provoquent la croissance ou la diminution exponentielle d’un stock. On les trouve partout où un élément du système peut se reproduire ou croître à une fraction constante de lui-même. Un exemple est l’intérêt sur un compte bancaire : plus il y a d’argent sur le compte, plus les intérêts générés sont importants, lesquels sont ajoutés au capital, ce qui conduit à générer encore plus d’intérêts, amplifiant ainsi la croissance du stock d’argent.
Conseils pour vivre dans un monde de systèmes par Donella H. Meadows
- Ressentez le rythme du système.
- Exposez vos modèles mentaux à la lumière du jour.
- Honorez, respectez et partagez l’information.
- Utilisez le langage avec soin et enrichissez-le de concepts systémiques.
- Prêtez attention à ce qui est important, pas seulement à ce qui est quantifiable.
- Concevez des politiques basées sur la rétroaction.
- Prenez soin du bien de l’ensemble.
- Écoutez la sagesse du système.
- Situez la responsabilité au sein du système.
- Restez humble, continuez d’apprendre.
- Célébrez la complexité.
- Élargissez vos horizons temporels.
- Remettez en question les disciplines.
- Élargissez les frontières de la bienveillance.
- Ne laissez pas s’éroder l’objectif de bonté.